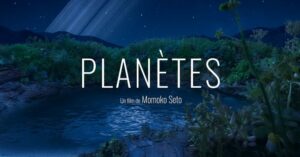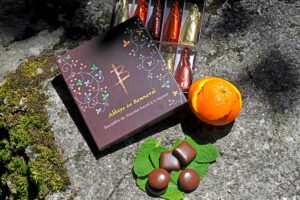LA TRANSHUMANCE
Histoire et son Ancrage dans l'Aubrac
La transhumance est une tradition ancestrale, née de la nécessité de nourrir les troupeaux en suivant les cycles des saisons. C’est une forme de pastoralisme itinérant qui a façonné les paysages, les sociétés et les cultures des régions rurales européennes, particulièrement en France. Parmi toutes les terres marquées par ce rite, l’Aubrac, vaste plateau volcanique et granitique du Massif central, conserve l’une des transhumances les plus emblématiques et vivantes.

Le mot « transhumance » vient du latin trans (au-delà) et humus (terre). Cette pratique remonte probablement à la Préhistoire, lorsque les premiers bergers comprirent qu’en déplaçant leurs animaux vers des pâturages d’altitude en été et vers les vallées en hiver, ils assuraient à leur cheptel une nourriture abondante et fraîche toute l’année.
En Europe, les premières traces écrites de la transhumance apparaissent chez les Grecs et les Romains. Ceux-ci reconnaissaient déjà l’importance économique et sociale du déplacement saisonnier des troupeaux. Au fil des siècles, cette pratique s’est institutionnalisée, s’accompagnant de la création de chemins spécifiques, de droits de passage, et d’une organisation collective entre éleveurs.
En France, la transhumance s’est développée dans toutes les régions montagneuses : Pyrénées, Alpes, Jura, Vosges, et bien sûr le Massif central, où l’Aubrac tient une place particulière.

L’Aubrac : terre de pâturages et de traditions
Le plateau de l’Aubrac s’étend sur trois départements : l’Aveyron, le Cantal et la Lozère. Son altitude moyenne (entre 1 000 et 1 400 mètres) et son climat rude en hiver mais doux en été en font un territoire idéal pour la pratique de la transhumance. Dès le Moyen Âge, les moines de l’abbaye d’Aubrac avaient déjà saisi l’intérêt d’organiser l’élevage sur ces hauts plateaux. Ils accueillaient les pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et entretenaient les chemins empruntés par les troupeaux.
Chaque printemps, à la fin mai, les éleveurs déplacent leurs vaches, principalement de race Aubrac, depuis les vallées vers les estives. Ces terres d’altitude leur offrent une herbe riche et abondante, propice à l’engraissement des bêtes. À l’automne, généralement en octobre, les troupeaux redescendent vers les bergeries pour passer l’hiver à l’abri.
Ce cycle immuable n’était pas simplement économique. Il marquait aussi les saisons dans la vie des habitants. Le départ en transhumance était et reste aujourd’hui encore une fête : les vaches sont décorées de couronnes de fleurs et de rubans colorés, les cloches (ou « sonnailles ») tintent, et toute la communauté se réunit pour célébrer ce moment.


La transhumance dans l’Aubrac n’est pas seulement un déplacement de bétail ; c’est devenu une grande fête populaire, attirant aujourd’hui des milliers de visiteurs. Chaque année, autour du 25 mai, la fête de la Transhumance de l’Aubrac se déroule à Aubrac, Nasbinals, ou encore Saint-Chély-d’Aubrac.
Les vaches, magnifiquement parées, sont les reines du jour. Des marchés de produits locaux, des démonstrations de savoir-faire artisanaux, des repas traditionnels — souvent autour de l’aligot, plat emblématique de la région — viennent compléter cette célébration. C’est un moment de transmission de la mémoire collective, un hommage à une agriculture respectueuse de la nature et des rythmes biologiques.
La transhumance de l’Aubrac est tellement ancrée dans la culture locale qu’elle a été proposée pour l’inscription au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, en même temps que d’autres formes de pastoralisme à travers le monde.
Si la transhumance était autrefois dictée par la nécessité, elle trouve aujourd’hui un nouveau sens dans un monde en quête d’agriculture durable. Ce mode d’élevage extensif permet de préserver la biodiversité des prairies naturelles, favorise une meilleure santé des troupeaux et limite l’érosion des sols.
Sur l’Aubrac, les estives abritent une faune et une flore remarquables, comme la gentiane jaune ou les narcisses sauvages. Les éleveurs, conscients de cet héritage, adaptent leurs pratiques : limitation du nombre d’animaux sur les estives pour éviter le surpâturage, entretien des chemins, respect des zones sensibles.
Cependant, la transhumance doit aujourd’hui composer avec de nouveaux défis : la pression foncière, les changements climatiques qui modifient la qualité des pâturages, la difficulté de recruter de jeunes éleveurs prêts à perpétuer ce mode de vie exigeant.
La transhumance n’est pas un simple vestige du passé. Dans l’Aubrac, elle continue de rythmer la vie des éleveurs et de structurer l’identité d’un territoire. Elle illustre une relation harmonieuse entre l’homme, l’animal et la nature, fondée sur l’adaptation et le respect des cycles naturels.
Chaque année, lorsque les cloches résonnent sur les plateaux et que les vaches parées de fleurs montent vers les estives, c’est tout un peuple qui célèbre non seulement ses racines, mais aussi son attachement à un mode de vie résolument tourné vers l’avenir.